À propos de Svidrigaïlov (« Crime et châtiment »)
- dutheilanne
- 25 août 2025
- 10 min de lecture
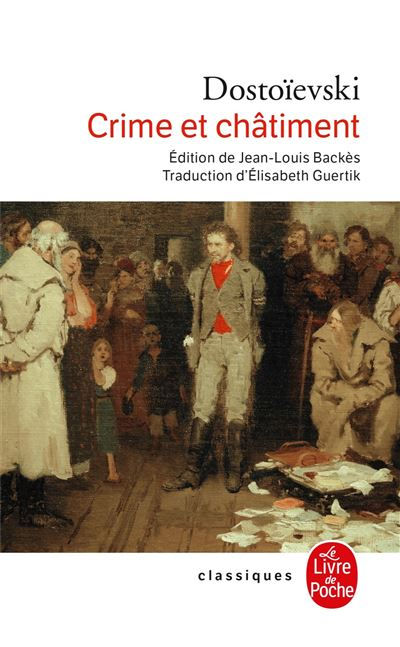
Si Rodion Romanovitch Raskolnikov, jeune étudiant à la dérive, peut être considéré comme le personnage principal de Crime et châtiment, Arcady Ivanovitch Svidrigaïlov n’est pas le personnage le moins ténébreux et le moins marquant de ce célèbre roman de Dostoïevski paru en 1866. Issu d’un milieu relativement modeste, sa malhonnêteté et son goût pour la tricherie ont conduit Svidrigaïlov en prison, d’où une femme de noble ascendance, Marthe Petrovna, l’a fait sortir en payant pour lui une caution de trente mille roubles. Au terme d’une vie conjugale marquée par un compromis entre le tempérament vicieux de son époux et sa propre exigence de respectabilité (au moins apparente), Marthe Petrovna mourra dans de troubles circonstances auxquelles son roué mari n’est peut-être pas étranger…
Svidrigaïlov n’apparaît « physiquement » qu’à la moitié du roman, au tout début de la quatrième partie, mais une réputation sulfureuse le précède, alimentée par le récit épistolaire de la mère de Rodion Romanovitch Raskolnikov, au sujet du séjour de sa fille Dounia (diminutif du prénom Avdotia), sœur de Rodion, en tant qu’institutrice auprès de la famille Svidrigaïlov.
Il semble qu’Arcady Ivanovitch, homme d’âge mûr, soit tombé fou amoureux de la jeune sœur de Raskolnikov, de plusieurs décennies sa cadette ; qu’après de vaines et grossières avances, il lui ait proposé de partir avec elle dans une autre région ou même à l’étranger. Après avoir été accusée par Marthe Petrovna, Dounia se trouve innocentée par les aveux de Svidrigaïlov lui-même, qui montre à son épouse une lettre où la jeune femme lui reproche sa mauvaise conduite ; lettre que Marthe Petrovna diffuse dans tout le voisinage, allant jusqu’à organiser des séances de lecture…
Svidrigaïlov est également soupçonné – si l’on en croit, du moins, des rumeurs persistantes –d’avoir abusé d’une très jeune fille et de l’avoir poussée au suicide ; d’avoir humilié un domestique, avec un résultat identique ; et d’avoir maltraité son épouse au point d’être, au moins indirectement, responsable de sa mort.
Ce personnage rappelle par son cynisme apparent le Nikolaï Stavroguine des Démons. En est-il un lui-même ? En tout cas, aucun scrupule de conscience ne semble se mettre en travers du chemin qu’il se propose pour satisfaire ses désirs. Oisif, pervers, jouisseur, tricheur… le lecteur est surpris d’apprendre au fil du récit que Svidrigaïlov, pour être une âme noire, est aussi une âme tourmentée. C’est probablement ce trait de vulnérabilité qui explique la relative indulgence de Dounia à son égard ; lui, aussi, qui peut expliquer la triste fin du personnage. Ses bonnes actions inattendues réorienteront le destin des personnages principaux, puisque c’est grâce à l’abri qu’il offre aux demi-frères et sœurs de Sonia et à l’argent qu’il donne à celle-ci, que la jeune fille pourra accompagner Raskolnikov dans son épreuve.

Curieusement, le portrait physique de Svidrigaïlov n’apparaît que dans la sixième partie du roman (chap. III) :
Raskolnikov posa son coude droit sur la table, appuya le menton sur les doigts de sa main droite et fixa les yeux sur Svidrigaïlov. Pendant une bonne minute il examina son visage qui le frappait toujours. C’était un étrange visage, pareil à un masque : blanc, le teint rose, les lèvres rouges, la barbe blond clair et les cheveux blonds encore assez épais. Les yeux semblaient trop bleus et leur regard était trop pesant et fixe. Il y avait quelque chose d’extrêmement déplaisant dans ce visage beau et très jeune pour son âge. Les vêtements d’été de Svidrigaïlov étaient élégants, légers, il soignait particulièrement son linge. À un doigt il portait une énorme bague avec une pierre de prix.
(F. Dostoïevski, Crime et Châtiment, trad. É. Guertik, Le livre de poche, p. 575.)
Un oisif élégant, donc, qui prend soin de lui, et dont le regard peut mettre mal à l’aise ; assez fortuné pour s’offrir un bijou de grande valeur. Svidrigaïlov se présente lui-même comme un homme aisé : « Je suis certes correctement habillé et je passe pour ne pas être pauvre ; la réforme agraire* elle-même nous a épargnés » (quatrième partie, chapitre premier, p. 356).
À Raskolnikov curieux de savoir si les rumeurs sont fondées concernant la mort de la jeune fille et celle du domestique, Svidrigaïlov répond en reportant les explications à plus tard (elles ne viendront jamais…), et semble plutôt fier de l’atmosphère sulfureuse qui l’entoure, tandis qu’il avoue franchement en avoir tiré avantage auprès de Dounia :
– Je crois qu’aux yeux de certains je peux en effet passer pour un personnage romanesque. Jugez donc des remerciements que je dois après cela à feue Marthe Petrovna pour avoir raconté à votre sœur tant de choses curieuses et pleines de mystère sur mon compte. […] En dépit de toute l’aversion naturelle qu’Avdotia Romanovna éprouvait à mon égard et de mon air habituellement sombre et repoussant, elle finit par avoir pitié de moi, pitié d’un homme perdu. Or, quand le cœur d’une jeune fille éprouve de la pitié, c’est, bien entendu, ce qu’il y a de plus dangereux pour elle. […] Je compris aussitôt que le petit oiseau volait de lui-même dans le filet et je me préparai à mon tour.
(P. 583.)
Hermétique aux théories à la mode (les « idées nouvelles »), plus lucide sur lui-même que peut l’être Raskolnikov, Svidrigaïlov pourrait cependant représenter un double « en creux » du jeune étudiant, dans une version cynique, lucide et résignée. Plutôt que d’implorer d’improbables pardons ou de titiller les autorités pour en espérer un châtiment salvateur, il entreprend à sa façon – fracassante et immorale – d’extirper un peu de mal du monde ; c’est du moins une interprétation possible de ses « coups de tête » charitables et de sa fin tragique.
Comme il l’explique lors de sa première apparition physique dans le roman (troisième partie, chapitre premier), bien que soumis à Marthe Petrovna, qui a conservé à toutes fins utiles une reconnaissance de dette pour la caution versée (« si j’avais eu l’idée de ma révolter en quoi que ce soit, ç’aurait été aussitôt les fers »), Svidrigaïlov ne craint pas d’avoir parfois recours à la violence.
– Réfléchissez donc : je n’ai donné que deux coups de cravache, il n’y a même pas eu de marques… Ne me prenez pas, je vous prie, pour un cynique : je sais parfaitement combien c’est ignoble de ma part, et ainsi de suite ; mais je sais aussi avec certitude que Marthe Petrovna a peut-être été contente de cet emballement de ma part, si j’ose dire. L’histoire de mademoiselle votre sœur était épuisée jusqu’au fond. Depuis deux jours déjà, Marthe Petrovna était forcée de rester à la maison : elle n’avait rien de nouveau à colporter en ville, du reste elle avait déjà excédé tout le monde avec sa lettre (vous avez certainement entendu parler de la lecture de cette lettre ?). Et voilà que subitement ces deux coups de cravache lui tombent comme du ciel ! Aussitôt elle a fait atteler !…
(P. 353.)
Marthe Petrovna garde le contrôle sur ses allées et venues mais lui permet certains voyages, et des loisirs :
– J’étais déjà allé à l’étranger et je m’y étais toujours ennuyé. Ce n’est pas tout à fait ce que je veux dire, mais, tenez, l’aube qui pointe, la baie de Naples, la mer : on regarde et on se sent triste. Le plus vexant c’est qu’on a en effet la nostalgie de quelque chose ! Vraiment on est mieux dans sa patrie : ici au moins on accuse les autres de tout et on s’innocente soi-même.
(P. 357.)
– Je faisais aussi venir des livres. Marthe Petrovna m’approuvait au début mais ensuite elle a craint que cela ne m’absorbe trop.
– Marthe Petrovna semble vous manquer beaucoup ?
– À moi ? Peut-être. Vraiment c’est possible. À propos, croyez-vous aux fantômes ?
– Quels fantômes ?
– Les fantômes ordinaires, quelle question !
– Et vous, vous y croyez ?
– Peut-être bien que non, pour vous plaire**… C’est-à-dire pas précisément non…
– Ils vous apparaissent donc ?
Svidrigaïlov le regarda d’un air bizarre.
– Marthe Petrovna veut bien me rendre visite, prononça-t-il en grimaçant un étrange sourire.
– Comment cela, elle veut bien vous rendre visite ?
– Il y a trois fois déjà qu’elle est venue. Pour la première fois, je l’ai vue le jour même de l’enterrement, une heure après le retour du cimetière. C’était la veille de mon départ pour ici. La deuxième fois avant-hier, pendant le voyage, à l’aube, à l’arrêt de Mala Vichera ; et la troisième fois il y a deux heures, dans l’appartement où je suis descendu.
– À l’état de veille ?
– Absolument. Les trois fois à l’état de veille. Elle vient, me parle une minute ou deux et sort par la porte ; toujours par la porte. On dirait même qu’on l’entend.
– Pourquoi ai-je bien pensé qu’il devait sûrement vous arriver quelque chose de ce genre ! fit soudain Raskolnikov. Et au même instant il s’étonna d’avoir dit cela. Il était en proie à une vive émotion.
– Vrai-ment ? Vous avez pensé cela ? demanda Svidrigaïlov avec surprise. Pas possible ? Ma foi, n’ai-je pas dit que nous avions un point commun, hein ?
– Jamais vous n’avez dit cela ! répondit Raskolnikov d’un ton brusque et emporté.
– Je ne l’ai pas dit ?
– Non !
– Il me semblait l’avoir dit. Tout à l’heure quand, en entrant, je vous ai vu couché les yeux fermés et faisant semblant de dormir, je me suis aussitôt dit : « C’est celui-là même ! »
– Qu’est-ce que cela veut dire « celui-là même » ? De quoi parlez-vous ? s’écria Raskolnikov.
– De quoi ? Mais je ne sais vraiment pas de quoi… balbutia sincèrement Svidrigaïlov comme s’il s’embrouillait lui-même.
Il y eut une minute de silence. Tous deux se regardaient intensément.
(P. 359.)
Il s’avère que le « fantôme » de Marthe Pétrovna tient à son époux des propos plutôt insignifiants, tels que : « Avec tous ces tracas vous avez oublié, Arcady Ivanovitch, de remonter aujourd’hui la pendule de la salle à manger » ; elle lui demande ce qu’il pense de sa nouvelle robe, ou lui reproche de vouloir se remarier alors qu’elle-même est à peine enterrée : « Si du moins vous choisissiez bien, mais je sais qu’il n’y aura aucun avantage ni pour elle ni pour vous, vous n’allez que faire rire les bonnes gens. » (P. 360.)
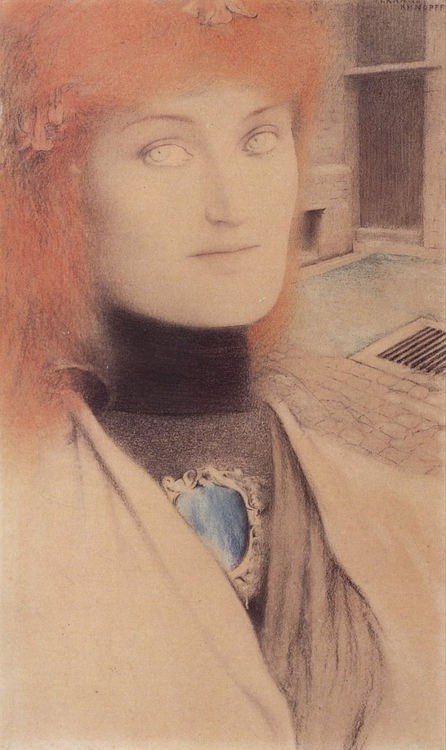
Après avoir écouté le récit de ces apparitions, Raskolnikov conseille à Svidrigaïlov d’aller consulter un médecin.
– Cela je le comprends sans vous que je suis malade, quoique je ne sache pas vraiment de quoi ; à mon sens, je suis peut-être cinq fois mieux portant que vous. Je ne vous ai pas demandé si vous croyez ou non à l’apparition des fantômes. Je vous ai demandé si vous croyez que les fantômes existent ?
– Non, rien ne m’y fera croire ! s’écria Raskolnikov presque avec colère.
– Que vous dit-on d’habitude ? marmonnait Svidrigaïlov comme pour lui-même, en regardant de côté et la tête légèrement inclinée. – Ils disent : « Tu es malade, donc ce que tu crois voir n’est que du délire et n’existe pas. » Et pourtant il n’y a pas là de stricte logique. J’admets que les fantômes n’apparaissent qu’aux malades ; mais cela ne prouve cependant qu’une chose : que les fantômes ne peuvent apparaître qu’aux malades, et non pas qu’en eux-mêmes ils n’existent pas.
– Bien sûr qu’ils n’existent pas ! insistait Raskolnikov avec irritation.
– Non ? C’est ce que vous pensez ? continua Svidrigaïlov en tournant lentement les yeux vers lui. –Voyons, si l’on raisonnait ainsi (aidez-moi donc) : « Les fantômes, ce sont pour ainsi dire des lambeaux et des fragments d’autres mondes, leur principe. L’homme bien portant n’a, bien entendu, nul besoin de les voir car l’homme bien portant est le plus terrestre des hommes et qui, pour le bon ordre, ne doit vivre que dans la vie d’ici-bas. Mais à peine tombe-t-il tant soit peu malade, à peine l’ordre terrestre normal se détraque-t-il dans son organisme, qu’aussitôt la possibilité de l’existence d’un autre monde commence à se manifester pour lui, et plus il est malade, plus les contacts avec l’autre monde sont nombreux, de sorte que lorsqu’il meurt pour de bon, il passe directement dans cet autre monde. » Il y a longtemps que mon opinion est faite à ce sujet. Si vous croyez à la vie future, vous pouvez aussi bien croire à cela.
– Je ne crois pas à la vie future, dit Raskolnikov.
Svidrigaïlov était songeur.
– Et s’il n’y avait là-bas que des araignées ou quelque chose de ce genre, dit-il soudain.
« C’est un fou », pensa Raskolnikov.
– Nous nous représentons toujours l’éternité comme une idée qu’on ne peut comprendre, comme quelque chose d’immense ! Mais pourquoi donc nécessairement immense ? Tout à coup, imaginez-vous qu’à la place de tout cela il n’y ait là-bas qu’un réduit, disons un peu comme des bains dans les campagnes russes, enfumé et avec des araignées dans tous les coins, et que ce soit là toute l’éternité. Il me semble voir parfois quelque chose de ce genre, vous savez.
– Est-il possible, est-il vraiment possible que vous ne vous représentiez rien de plus consolant et de plus juste que cela ! s’exclama Raskolnikov avec un sentiment de malaise.
– De plus juste ? Mais comment savoir, peut-être est-ce précisément cela qui est juste et, vous savez, je n’aurais pas manqué de l’organiser exprès ainsi, répondit Svidrigaïlov en souriant vaguement.
À cette monstrueuse réponse Raskolnikov fut comme saisi de froid. Svidrigaïlov leva la tête, le regarda fixement et éclata soudain de rire.
– Non, réfléchissez donc à ceci, cria-t-il. Il y a une demi-heure, nous ne nous étions même jamais vus encore, nous passons pour ennemis, il y a entre nous une question non réglée ; nous abandonnons cette question, et voilà dans quelle littérature nous nous lançons ! N’ai-je pas dit vrai que nous étions du même bord ?
(P. 362.)
Il est paradoxal et assez comique que Raskolnikov, chez qui son entourage soupçonne des troubles mentaux en raison de son comportement incompréhensible, s’exclame intérieurement au sujet de Svidrigaïlov : « C’est un fou. » Surprenant, également, que Raskolnikov l’athée, le matérialiste raisonneur, trouve choquante la vision de l’éternité proposée par Svidrigaïlov (« est-il vraiment possible que vous ne vous représentiez rien de plus consolant et de plus juste que cela ! »). Étonnant aussi qu’il ne prête pas une oreille plus attentive à la démonstration de son interlocuteur au sujet des « fantômes » ; originale, certes, mais indubitablement rationnelle.
Il faut dire que Raskolnikov est un personnage peu conscient, souvent spectateur étonné de ses propres pensées, et des lieux où ses pas le mènent : par exemple, comment, ayant prévu de se rendre chez son ami Razoumikhine, se retrouve-t-il aux Îles, après avoir un instant voulu rentrer chez lui ? se demande-t-il (première partie, cinquième chapitre). À l’opposé de la lucidité malheureuse de Svidrigaïlov, les ratiocinations de Raskolnikov sont marquées d’une mauvaise foi dont il semble chercher à se défaire et qui lui colle à la peau comme la moiteur de l’atmosphère dans cet été pétersbourgeois caniculaire.
Pour être déroutants et souvent répugnants, les récits et raisonnements de Svidrigaïlov n’en sont pas moins sincères, cohérents et attachés à une certaine rationalité.
La discussion prend la forme d’une interview : Raskolnikov pose des questions courtes, auxquelles sont interlocuteur répond de façon détaillée. Les « sorties » de Svidrigaïlov peignent le personnage mieux que ne le ferait une longue description. Dans ce chapitre, Arcady Ivanovitch souligne une sorte de lien mystérieux entre le jeune homme et lui-même, dont il ne précise pas la nature : « C’est celui-là même ! » – en russe : Это тот самый и есть !
Ce тот самый, « celui-là même », intrigue Raskolnikov au plus haut point, mais seule une minute de silence répondra à son interrogation…
Le mystère de leurs personnalités respectives et de leur éventuelle « connexion » reste entier, mais il est sans doute significatif que ces deux personnages qui cheminent dans les marges de la loi et de la morale se rencontrent à mi-parcours et confrontent, comme en écho, leurs psychés tortueuses.

* Réforme agraire : Svidrigaïlov fait certainement référence à la récente abolition du servage par Alexandre II.
** En français dans le texte.



Commentaires