Assis dans son âme : à propos de Smerdiakov dans « Les Frères Karamazov » de Dostoïevski
- dutheilanne
- 20 sept. 2025
- 9 min de lecture
« C’est l’histoire d’une famille recomposée très dysfonctionnelle, dont les mères sont exclues (parce que mortes) », pourrait-on dire des Frères Karamazov de Dostoïevski. C’est en tout cas l’histoire de trois frères et de leur père ; et quand il y a trois frères, quoi de mieux, finalement, que l’apparition d’un quatrième, pour que se noue une solide intrigue autour de la jalousie, de la reconnaissance et de la vengeance.
Après avoir été abandonnés par leur père et élevés grâce à la générosité d’un cousin éloigné, en ce qui concerne Dmitri (aussi appelé Mitia), et de leurs tantes pour Ivan et Alexeï (Aliocha), les trois frères sont de retour au bercail paternel. Dmitri (issu d’une première union) pour réclamer une somme d’argent dont il estime avoir été spolié, Ivan, prétendument pour défendre les intérêts de Dmitri, et Alexeï en vue d’effectuer une retraite dans un monastère avoisinant.

À son arrivée chez son père, Ivan Fiodorovitch Karamazov, le deuxième fils de Fiodor Pavlovitch Karamazov, qui est un peu l’intellectuel de la famille (il a fréquenté l’université et publié des articles qui l’ont fait remarquer de plusieurs cercles littéraires), avait commencé par s’intéresser à Pavel Fiodorovitch Smerdiakov, le fils de la Smerdiachtchaïa (« la Puante »). Cette vagabonde, Lizavéta, « folle en Christ » (юродивая, « innocente », « folle sainte »), est morte en mettant son bébé au monde dans la bania du vieux Karamazov, dont une rumeur tenace assure qu’il est le père de l’enfant, ce qui n’aurait rien de très surprenant au vu du degré de dépravation du personnage.
Smerdiakov porte d’ailleurs, non seulement le patronyme de Fiodorovitch, tel un vrai fils de Fiodor, mais aussi, en guise de prénom, celui de son possible grand-père : Pavel, qui n’apparaît pas dans le roman mais dont on déduit le prénom du patronyme de Fiodor Pavlovitch (chaque enfant russe portant en guise de patronyme le prénom de son père auquel on ajoute « fils de » ou « fille de » : -ovitch ou -evitch / -ovna ou -evna…).
Ce fils putatif n’a aucun droit à l’héritage, il a simplement celui de servir les autres, en tant que laquais, et de vivre dans l’annexe des domestiques ou de dormir sur un banc dans le vestibule. Recueilli par le serviteur Grigori et sa femme Marfa, comme « en remplacement » de leur fils mort-né, il a très vite suscité chez eux une certaine répulsion par son caractère sauvage et énigmatique. Doué pour la cuisine – il envisage d’ouvrir un restaurant à Moscou – il dit détester « toute la Russie » et regretter que Napoléon ne s’en soit pas emparé en 1812, sans paraître affecté de se retrouver, de fait, dans le camp des traîtres. D’ailleurs, ce n’est sans doute pas un hasard si le seul talent qu’il ait développé est celui de la cuisine (un art très français), et si dans la quatrième partie du roman, il apprend des mots français transcrits en cyrillique dans un cahier. (On imagine la considération que Dostoïevski, pas vraiment francophile, aurait éprouvée à l’égard d’un tel personnage dans la réalité…)
Attiré par la personnalité d’Ivan Karamazov, Smerdiakov tente de nouer avec lui une relation de complicité forcée qui met Ivan mal à l’aise, puis le rend de plus en plus furieux à son égard. Sous couvert de discussions philosophiques et métaphysiques, Smerdiakov semble couver un projet de revanche nourri par son orgueil et son amertume à l’égard d’une famille qui l’a toujours méprisé. Il trouve le moyen de lier une relation utile avec chacun des membres de la maisonnée, tout en se présentant comme une victime : victime de Dmitri, qui le harcèle au sujet de la jeune Grouchenka dont il est amoureux, victime du père Karamazov, obsédé, lui aussi, par l’hypothétique venue de la jeune femme, qu’il souhaite épouser, victime aussi du prétendu manque de coopération d’Ivan, qui tarde à « se rendre à Tchermachnia » où son père le presse pourtant d’aller… absence qui permettrait à Smerdiakov de mettre en œuvre un plan machiavélique.
« Toi, tu m’as tout l’air d’un sombre idiot et, pour sûr… d’une sale canaille ! » lui dit Ivan Fiodorovitch à la fin de leur conversation (trad. E. Lavigne). Ou, dans la traduction d’André Markowicz : « Je crois que tu es un grand idiot et, ça va de soi… un salopard terrible ! »
Idiot ou salopard (enfant, il aimait déjà pendre les chats, puis les inhumer avec le plus méticuleux cérémonial), il apparaît en tout cas avec évidence, dès le début du roman, que Smerdiakov cherche à établir avec Ivan – à lui imposer, plutôt – une relation de mentor à disciple. Ayant eu connaissance des idées nihilistes d’Ivan : « Si Dieu n’existe pas, alors tout est permis », il s’est pris d’admiration pour lui. Il faut dire qu’enfant, Smerdiakov demandait déjà à son tuteur de circonstance, Grigori, d’où venait la lumière du « premier jour » si Dieu n’avait créé le soleil, la lune et les étoiles que « le quatrième » ; s’attirant par là une gifle magistrale qui fut peut-être à l’origine de son épilepsie. Et c’est visiblement en l’honneur d’Ivan, et afin de le séduire, qu’il parade devant la maisonnée en provoquant le domestique Grigori à propos de religion.
Il est sans doute significatif, à cet instant (Ire partie, livre III chap. 6), que le père, Fiodor Pavlovitch Karamazov, traite Smerdiakov « d’ânesse de Balaam ». Cet animal biblique, apparaissant dans le livre des Nombres, s’est mis subitement à parler pour protester contre son maître qui, incapable de voir l’ange de Dieu posté devant lui, s’obstinait à battre sa monture afin de poursuivre son voyage en vue de chasser les Hébreux nouvellement arrivés au pays de Moab. Si Fiodor Pavlovitch Karamazov, lui, ne bat pas Smerdiakov, le lien de sujétion est bien là, irréductible et humiliant pour le fils illégitime, laquais et cuisinier au service de son père.
Autre raison possible de cette référence à l’ânesse miraculeuse : Smerdiakov, habituellement, ne parle pas, ou si peu ; et subitement, après avoir entendu Grigori raconter un fait divers – un soldat russe tombé entre les mains d’ennemis, qui avait préféré se laisser écorcher vif plutôt que de renier sa foi chrétienne et d’embrasser la foi islamique – voilà qu’il se met à parler, « d’une voix forte, en surprenant tout le monde ».
Smerdiakov argue qu’il pourrait très bien avoir renié sa foi chrétienne pour sauver sa vie, sans pour autant commettre de péché, puisque dès le moment où il l’aurait reniée, il aurait été excommunié par Dieu et n’aurait, de fait, plus été chrétien ; avec pour conséquence de ne pas avoir besoin de mentir en affirmant embrasser une autre foi. Le sophisme, variante du paradoxe du menteur (au moment où je dis « je mens », je ne suis plus un menteur), est patent, mais le pauvre Grigori, très pieux, se trouve bouleversé par la malice de Smerdiakov.
À Fiodor Pavlovitch qui lui fait observer que, malgré tout, il aurait quand même abjuré sa foi et, par là, provoqué la colère divine, Smerdiakov rétorque tranquillement – au grand scandale de Grigori – qu’un défaut de foi ne doit pas être un grand péché, puisque personne sur terre n’est capable d’obtenir d’une montagne qu’elle se jette dans la mer, « à part peut-être un seul homme, deux tout au plus », alors que les Écritures affirment qu’il suffit d’une once de foi pour réussir cette prouesse.
À bout d’arguments, Fiodor Pavlovitch lui fait alors remarquer qu’il renierait sa foi au moment où il n’aurait plus que cela à penser, ce qui lui semble déplorable, tandis que lui-même n’est incroyant que par « étourderie », par manque de temps (« on n’a déjà pas le temps de dormir tout son saoul, alors se repentir, je n’en parle pas »). Smerdiakov, jamais à bout de ressources, lui démontre que si, plein d’une foi incontestable, il a d’abord tenté pour sauver sa vie de demander à une montagne de venir écraser ses tortionnaires, et que cela ne s’est pas produit, il peut légitimement se mettre à douter, considérer que sa foi n’est pas estimée bien cher « là-haut », voire perdre la raison, toutes circonstances qui ne peuvent que lui attirer l’indulgence du Seigneur…
La brillante prestation de Smerdiakov ne semble guère atteindre son but auprès d’Ivan, qui n’affiche pour lui que mépris.
« C’est toi qui l’intéresses tant, qu’est-ce que tu as fait pour l’amadouer ? » lui demande son père.
« Rien du tout », répond Ivan. « C’est lui qui s’est avisé de me respecter ; c’est un laquais et un mufle. Et ce sera de la chair à canon progressiste le moment venu, d’ailleurs. »
Un peu plus loin, son père reprend : « Tu vois, je sais que moi non plus, il ne peut pas me sentir, pas plus que les autres, et c’est pareil pour toi, même si tu as l’impression qu’il “s’est avisé de te respecter”. Aliochka, c’est encore pire : Aliochka, il le méprise. Mais il n’est pas voleur, voilà, il n’est pas bavard, il sait tenir sa langue, il n’ira pas déballer le linge sale, ses koulibiaks sont très bons, et puis qu’il aille au diable, vraiment, est-ce qu’il vaut la peine qu’on parle de lui ?
– Bien sûr que non », répond Ivan, qui ne mesure pas encore les capacités de nuisance du fils de « Lizavéta la Puante ».

Dans la IIe partie du roman (livre V, chap. 6), après avoir exposé à son frère Aliocha ses idées sur la religion et raconté sa parabole du « Grand Inquisiteur », où Jésus revient parmi les hommes mais est immédiatement rejeté par l’Église, Ivan Fiodorovitch rentre « à la maison », c’est-à-dire à la maison de son père. Envahi par un sentiment d’angoisse puissant mais diffus, il aperçoit tout à coup le laquais Smerdiakov assis sur un banc près de l’entrée et saisit en un éclair l’origine de son angoisse.
Smerdiakov le laquais était assis sur le banc près du portail et prenait le frais en profitant de l’air du soir, et Ivan Fiodorovitch comprit dès le premier regard que Smerdiakov le laquais était également assis sur son âme et que c’était de cette personne-là que son âme n’arrivait pas à se débarrasser. Tout s’était soudain illuminé, tout était devenu clair. Plus tôt, alors qu’Aliocha lui faisait encore le récit de sa rencontre avec Smerdiakov, quelque chose de sombre et de répugnant s’était soudain fiché dans son cœur, qui y avait répondu par de la colère. Et puis, au cours de la conversation, Smerdiakov s’était fait oublier pour un temps, mais il était resté dans son âme, et sitôt qu’Ivan Fiodorovitch avait quitté Aliocha pour partir seul chez lui, l’impression oubliée avait soudain resurgi. « Je ne peux pas croire que ce sale vaurien me perturbe à ce point ! » lui passa-t-il par la tête avec une colère insupportable.
(Traduction d’Emma Lavigne, éd. Gallmeister, coll. Litera, t. Ier, p. 520-521.)
L’expression « assis sur son âme », qui est plutôt : « assis dans son âme » si l’on traduit littéralement в душе его сидел, saisit l’esprit du lecteur par sa force d’expression. Telle une écharde, Smerdiakov s’est « fiché », « incrusté » dans le cœur d’Ivan ; entité sombre et répugnante que le jeune homme abrite en son sein, mais dont il est lui, en réalité, le captif.
La force de ce passage a été rendue très inégalement par les différentes traductions. Comparons par exemple :
Emma Lavigne (éd. Gallmeister, coll. Litera, t. Ier, p. 520) :
Smerdiakov le laquais était assis sur le banc près du portail et prenait le frais en profitant de l’air du soir, et Ivan Fiodorovitch comprit dès le premier regard que Smerdiakov le laquais était également assis sur son âme et que c’était de cette personne-là que son âme n’arrivait pas à se débarrasser.
Le texte original dit plutôt « dans son âme » que « sur son âme », mais l’idée est là.
Henri Mongault (Gallimard, Folio, t. Ier, p. 369) :
Assis sur un banc, près de la porte cochère, le valet Smerdiakov prenait le frais. Au premier regard Ivan comprit que ce Smerdiakov lui pesait et que son âme ne pouvait le supporter.
Disparition de la notion de soir, pourtant présente dans le texte original (вечерним воздухом), et disparition de l’image du valet « assis dans son âme » (remplacé par « lui pesait »), d’où un affadissement du texte. Disparu aussi le patronyme d’Ivan, qui suit très souvent le prénom en russe ; Ivan Fiodorovitch est devenu tout simplement Ivan, sans que le sens global de la phrase soit affecté mais en perdant au passage un élément culturel important.
André Markowicz (Actes Sud, Babel, t. Ier, p. 480) :
Sur le banc à côté du portail, le laquais Smerdiakov était assis à prendre la fraîcheur du soir, et Ivan Fiodorovitch, au premier regard qu’il lui lança, comprit que, le laquais Smerdiakov, c’était aussi dans son âme qu’il s’était assis, et que c’était précisément cet homme-là que son âme n’arrivait pas à supporter.
L’ensemble des notions du texte original semble au rendez-vous.
La traduction « supporter » (H. Mongault et A. Markowicz) ou « se débarrasser de » (E. Lavigne) pour вынести relève de choix peut-être aussi légitimes l’un que l’autre, bien que « supporter » corresponde mieux à une traduction littérale.
L’image, si forte, du laquais « assis dans l’âme » d’Ivan Karamazov est d’importance, car elle est au centre de la relation malsaine entre les deux hommes, qui n’est pas sans rappeler, par certains aspects, la relation Nikolaï Stavroguine - Piotr Verkhovenski dans Les Démons. D’où l’importance, certainement, de rester au plus près du texte original dans la traduction de ce passage.
À ce point du roman, le lecteur devine déjà qu’il sera bien difficile d’extirper Smerdiakov, mort ou vif, de l’âme d’Ivan…


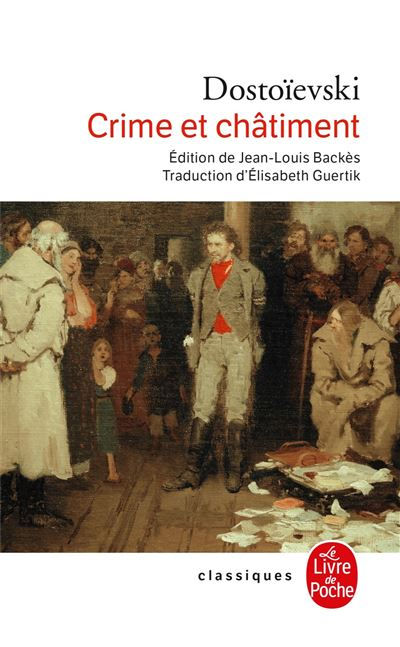
Commentaires