Małgorzata Lebda, « Vorace »
- dutheilanne
- 22 janv.
- 4 min de lecture

Małgorzata Lebda, Vorace, traduit du polonais par Lydia Waleryszak, Les éditions Noir sur Blanc, 2026 pour la traduction française.
Un coin de campagne en Pologne, une petite ferme parmi d’autres où la grand-mère de la narratrice s’éteint doucement, entourée d’animaux minuscules ou grands qu’elle accueille toujours avec amour, bravant le pragmatisme de son époux qui ne voit pas l’intérêt d’héberger mouches, araignées et papillons de nuit. C’est en compagnie, non seulement de cet homme plutôt discret qui s’active à réparer tout ce qui peut l’être dans la maison, mais aussi de sa petite-fille – qui raconte cette histoire – et de son amie Ann, que Grand-mère Róża vit ses derniers jours, dans l’acceptation de la vie et de la mort telles qu’elles se présentent. C’est-à-dire sous un jour pas nécessairement idyllique, car la nature, à laquelle appartiennent aussi les hommes, leurs artefacts, leurs usines polluantes et leurs abattoirs, tour à tour crée ou engloutit ce qu’elle a elle-même créé. Une colline instable s’effondre, un homme meurt, son chien survit, une vache sombre dans un abîme… et le cancer ronge le corps de Grand-mère Róża.
Sa petite-fille, qui gagne sa vie grâce aux nouvelles technologies si l’on en croit les lignes de code qu’elle envoie régulièrement à son employeur « au-delà de l’océan », est toute à l’écoute de cette Grand-mère magicienne qui semble faire corps avec l’ensemble du vivant, et de son amie Ann, dont le métier consiste dans « l’étude de la lumière ». Et même du chien Dunaj, qui a peur de l’orage.
De temps à autre, le voisin Staszek toque à la porte. Aux antipodes du grand-père avec qui se révèle radicalement incompatible, il représente la « viande morte », l’abattoir et sa colline bétonnée. Mais une raison mystérieuse semble le pousser à apporter de la viande pour Róża…
Avec Vorace, paru en 2023 en Pologne sous le titre Łakome, la poétesse Małgorzata Lebda signe un premier roman déjà salué par la critique polonaise, une œuvre d’une subtile poésie et d’une grande profondeur. La traductrice Lydia Waleryszak nous permet à présent de le découvrir en français.
Extraits :
Grand-mère met un point d’honneur à défendre le vivant, mais elle accepte aussi la mort. Cela arrive quand Grand-père lève la main sur un pigeon, c’est l’unique cas où elle ne proteste pas. Elle veille à protéger toutes les autres vies comme si c’était la sienne.
Si une grosse mouche, de celles qui se repaissent de la viande des vaches de l’abattoir et qui se posent sur la bouse des vaches de l’abattoir, si une telle mouche (Grand-mère appelle ces insectes gras et luisants des « mouches à merde ») entre dans la chambre de Grand-mère, elle est assurée d’une tranquillité à vie. J’appelle cela depuis des années : la retraite des mouches.
Il a toujours été interdit, et cette règle s’applique encore aujourd’hui, de tuer quelque être vivant que ce soit dans la chambre de ma grand-mère ou de l’en faire sortir. Enfin presque. Avant d’entamer les travaux de peinture, nous avons dû, Ann et moi, procéder à une évacuation solennelle.
Grand-mère était là, elle veillait à son bon déroulement. De l’index, elle désignait des recoins : Ici, là, et encore là, là-bas, derrière le tableau, sous l’armoire, dans l’interstice entre les planches.
Dans des bocaux, la vie d’une multitude de petites bêtes est passée entre nos mains. De nombreuses araignées de la famille des pholcidae et beaucoup, beaucoup de faucheux.
L’ensemble du vivant est resté vivant.
Et maintenant, la vie revient. Il est probable que les araignées qui tissent leurs toiles soient demeurées les mêmes. La chambre de Grand-mère leur offre des conditions particulièrement propices. J’imagine ces petites bêtes communiquer entre elles pour dire « Je vais chez Róża » comme on dit « Je vais en cure ».
(Vorace, op. cit. p. 37-38.)
L’orage s’éloigne derrière la crête, il disparaît au nord, chute dans le lac. Dunaj est auprès de Grand-mère, il frissonne.
La forêt toute proche s’apaise.
La nuit nous emporte.
Au petit matin, je trouve la chien étendu au côté de Grand-mère. À tout instant, il agit violemment ses pattes, comme s’il courait après une proie. Ses mâchoires bougent, peut-être attrape-t-il quelque chose dans sa gueule.
Il rêve de gibier, je note.
J’embrasse son museau qu’il ouvre et referme en rêve. C’est avec ce museau qu’il nous apporte des têtes de l’abattoir. Au printemps dernier, à la Pentecôte, notre cour était jonchée de têtes de vache.
Un chien de chasse qui rapporte de la charogne. Grand-père a remué la tête.
Ce matin-là, j’ai rassemblé les têtes de vache et je les ai déposées sur le chaintre qui sépare notre terrain de celui de l’abattoir. Avec le temps, leur nombre augmente, il y a aussi des têtes de cochon et de cheval. La nature s’en occupe à sa façon. Elle décompose par-ci, grignote par-là, polit jusqu’à l’os.
Ces têtes d’animaux vont bientôt atteindre les premières branches des frênes, je songe.
Les mouches à merde qui luisent au soleil s’en nourrissent. Leur odeur s’épanouit et libère des arômes putrides.
Dunaj se réveille et change de position, il s’allonge sur le dos. Le corps du chien est aussi grand que Grand-mère amenuisée par la maladie. Elle dort toujours. Je pose mes mains sur ces deux corps. Chez l’un comme chez l’autre, la cage thoracique se soulève et s’abaisse, elle se soulève et s’abaisse, elle se soulève et s’abaisse.
(Vorace, op. cit., p. 112-113.)



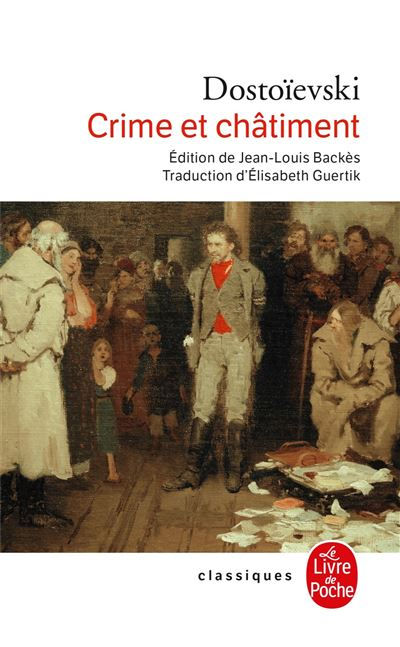
Commentaires